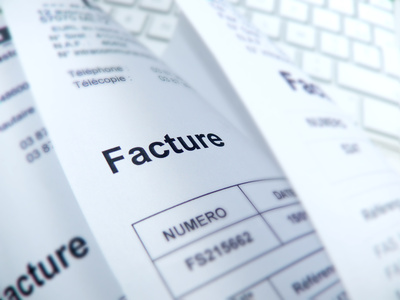
En cas d’absence d’indication de temps de règlement indiqués dans les C.G.V, la durée est de 30 jours à compter de la date de livraison de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de service. Néanmoins pour réduire votre BFR, vous pouvez négocier des délais de paiement plus courts avec certains de vos clients.
Termes de paiements
Les délais de paiement sont une préoccupation fondamentale tant dans l’Union européenne qu’en France, car ils ont un impact sur la compétitivité des entreprises. Outre les distorsions de concurrence et les abus de position dominante qu’elles peuvent entraîner, l’utilisation systématique des durées de règlement peut être considérée comme un « crédit fournisseur » devenu la première source de financement à court terme des entreprises, notamment des sociétés de distribution.
Les termes de règlement correspondent aux délais de remboursement accordées à de vos clients. La Loi LME s’applique à toutes les activités, quelles qu’elles soient sur le territoire français.
En droit français, les conditions de versement des contrats de vente ou de services (à l’exclusion de l’alimentation) sont strictement réglementées (art. L441-10.I Code de commerce) comme suit :
- Sauf accord contraire entre les parties, le délai normal de règlement des sommes dues ne peut excéder 30 jours
- Les parties peuvent convenir d’un moment de paiement qui ne peut pas dépasser 60 jours après la date de la facture
- Par dérogation, un temps maximal de 45 journées à compter de la fin du mois suivant la date de la facturation peut être convenu entre les parties, à condition que cet échéance soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus flagrant à l’égard du créancier (par exemple, il pourrait en fait aller jusqu’à 75 jours après la date d’émission).
- Différents prorogations maximaux pour des produits spécifiques, notamment 30 jours pour les denrées périssables et congelées, l’alcool et les services de transport, et 20 jours pour le bétail vivant et la viande fraîche, entre autres.
En France, tout producteur, prestataire, grossiste ou importateur doit communiquer ses contraintes et à tout acheteur de biens ou de services agissant en qualité de professionnel. Ils peuvent bien sûr aussi accepter des conditions de vente particulières.
Ce préavis doit être obligatoirement inscrit sur la facture pour formaliser la transaction.

- Les délais de règlement en « X jours calendaires ». Cette méthode est simple à calculer, il suffit de rajouter le nombre de journée nécessaire à partir de la date d’émission de la facture.
- Les termes de paiement « X jrs après l’édition de facturation, fin de mois ». Cette méthode permet de rallonger les durées accordés. Il faut ajouter le nombre de journée indiqués dans le terme de règlement à la date de sortie de la facturation.
Le versement interviendra à la fin du mois indiqué par le calcul.
Exemples de délais de paiement
Exemple 45 jours à la date de facture :
Avec une facturation datée du 01 Mars 2016 avec un terme de remboursement de « 45 journées après émission de la facturation », le versement doit intervenir au plus tard dans un délai de 45 jrs calendaires, soit le 14 Avril.
Exemple 45 jrs fin de mois :
Avec une créance datée du 01 Mars 2016 avec un terme de paiement de « 45 journées après édition de la facture, fin de mois », il faut ajouter une prolongation de 45 jours calendaires, soit le 14 Avril et attendre la fin du mois pour obtenir le règlement.
Par conséquent, le règlement interviendra à la fin du mois d’Avril soit le 30 Avril.
Réglementation européenne des délais de paiement
Les Etats membres Européens doivent se conformer à la directive Européenne sur les délais de remboursement (directive 2011/7/UE).
Cette directive européenne précise les temps de paiement :
- Un maximum de 30 jours (pour des circonstances très exceptionnelles délai de 60 journées ) pour la livraison de biens et l’exécution de services pour les autorités publiques.
- Un maximum de 60 jrs à compter de la date d’émission de la facture pour les crédit inter-entreprises.
Les outils et solutions pour respecter et optimiser les délais de paiement
Respecter la loi tout en optimisant sa trésorerie passe aussi par une bonne organisation interne. Les entreprises les plus performantes mettent en place :
- Un logiciel de facturation permettant de suivre précisément les échéances et d’automatiser l’envoi des factures.
- Des relances clients automatisées, pour rappeler les échéances avant même qu’elles ne soient dépassées.
- L’affacturage ou l’assurance-crédit pour sécuriser le poste client et obtenir des liquidités sans attendre l’échéance.
- Des procédures claires en interne pour valider rapidement les prestations réalisées et émettre la facture sans délai.
Les PME peuvent aussi négocier avec leurs clients l’usage de la facturation électronique, bientôt obligatoire en France, qui accélère les processus et réduit le risque de retard dû à la perte ou à l’oubli d’un document.
L’assurance-crédit : sécuriser ses créances face aux délais de paiement
Même si la Loi LME encadre strictement les délais de paiement, elle ne garantit pas le règlement effectif des factures. Un client peut respecter le délai légal, mais être en difficulté financière au moment de payer, voire devenir insolvable. C’est là qu’intervient l’assurance-crédit, un outil stratégique pour sécuriser son poste client.
Le principe est simple : l’entreprise cède à un assureur-crédit (comme Allianz Trade, Atradius ou Coface) tout ou partie de son risque d’impayé. En échange d’une prime, l’assureur surveille la solvabilité des clients, fixe des limites de crédit adaptées et indemnise l’entreprise en cas de défaut de paiement.
L’assurance-crédit est particulièrement utile dans les secteurs où les marges sont faibles et les délais longs, car elle permet :
- De protéger la trésorerie en cas de non-paiement.
- De prévenir les risques grâce à un suivi en temps réel de la santé financière des clients.
- De faciliter le financement, notamment auprès des banques ou factors, qui sont plus enclins à accorder des lignes de crédit lorsque les factures sont couvertes.
Certaines entreprises combinent même l’assurance-crédit avec l’affacturage : le factor récupère immédiatement le montant de la facture, tandis que l’assureur garantit le paiement en cas de défaillance du client. Cette double protection est un levier puissant pour sécuriser le développement commercial sans subir la pression des délais de paiement.
Conséquences sur le BFR et la trésorerie des entreprises
Un délai de paiement, c’est en réalité un crédit accordé par le fournisseur à son client. Plus il est long, plus il augmente le Besoin en Fonds de Roulement (BFR), c’est-à-dire le montant nécessaire pour financer le cycle d’exploitation de l’entreprise.
Par exemple, pour un fournisseur réalisant 1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, passer de 45 à 60 jours de règlement peut immobiliser plusieurs dizaines de milliers d’euros supplémentaires. Cette trésorerie bloquée peut limiter la capacité à investir, à payer ses propres fournisseurs ou à recruter.
Pour réduire cet impact, certaines entreprises recourent à l’affacturage, qui permet de transformer immédiatement une facture en liquidités, ou encore à l’escompte bancaire. D’autres privilégient la facturation anticipée ou la facturation intermédiaire pour réduire l’exposition.
Les sanctions en cas de non-respect des délais
Le non-respect des délais de paiement prévus par la Loi LME n’est pas qu’un simple manquement contractuel : il peut entraîner de lourdes sanctions administratives. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) est l’organisme chargé de contrôler le respect de ces règles.
En pratique, les amendes peuvent atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale. Ces sanctions peuvent même être doublées en cas de récidive. L’autorité administrative prend en compte non seulement le dépassement des délais, mais aussi le caractère systématique ou abusif de la pratique.
Ces dernières années, plusieurs grandes entreprises, notamment dans la grande distribution et l’industrie, ont été sanctionnées pour avoir imposé à leurs fournisseurs des délais supérieurs à la limite légale. Outre l’aspect financier, ces affaires ont souvent eu un impact négatif sur leur image, donnant l’impression de profiter de leur puissance pour fragiliser des partenaires plus petits.
Les exceptions sectorielles prévues par la loi
Si la règle générale fixe un plafond de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou 45 jours fin de mois), certaines activités bénéficient de dérogations, souvent pour tenir compte de spécificités logistiques ou commerciales.
- Produits alimentaires périssables : délai maximal de 30 jours après la fin de la décade de livraison.
- Viande fraîche et bétail vivant : délai limité à 20 jours après la livraison, afin de sécuriser les éleveurs.
- Produits surgelés : 30 jours maximum après réception.
- Boissons alcoolisées soumises aux droits de consommation : délai plafonné à 30 jours.
- Services de transport : 30 jours à compter de l’exécution de la prestation.
Ces dérogations sont inscrites dans le Code de commerce et répondent à un impératif : protéger les fournisseurs de secteurs où la marchandise est fragile ou soumise à des cycles financiers spécifiques.
Négociation et aménagement contractuel des délais de paiement
La Loi LME fixe des plafonds, mais dans la pratique, il reste possible de négocier des délais plus courts, ce qui peut représenter un véritable levier de trésorerie pour l’entreprise.
Un fournisseur en position de force, parce qu’il offre un produit rare, de qualité reconnue, ou qu’il dispose d’une forte notoriété, peut obtenir de ses clients un règlement à 30 jours, voire comptant. À l’inverse, un jeune prestataire peut, pour séduire un gros client, accepter le délai maximal légal, mais à condition de sécuriser le paiement par des garanties (assurance-crédit, acompte, lettre de change…).
La clé est de formaliser systématiquement l’accord par écrit, soit dans les conditions générales de vente (CGV), soit dans le contrat commercial. En cas de contrôle, l’absence de mention claire ouvre la porte à des interprétations défavorables.



